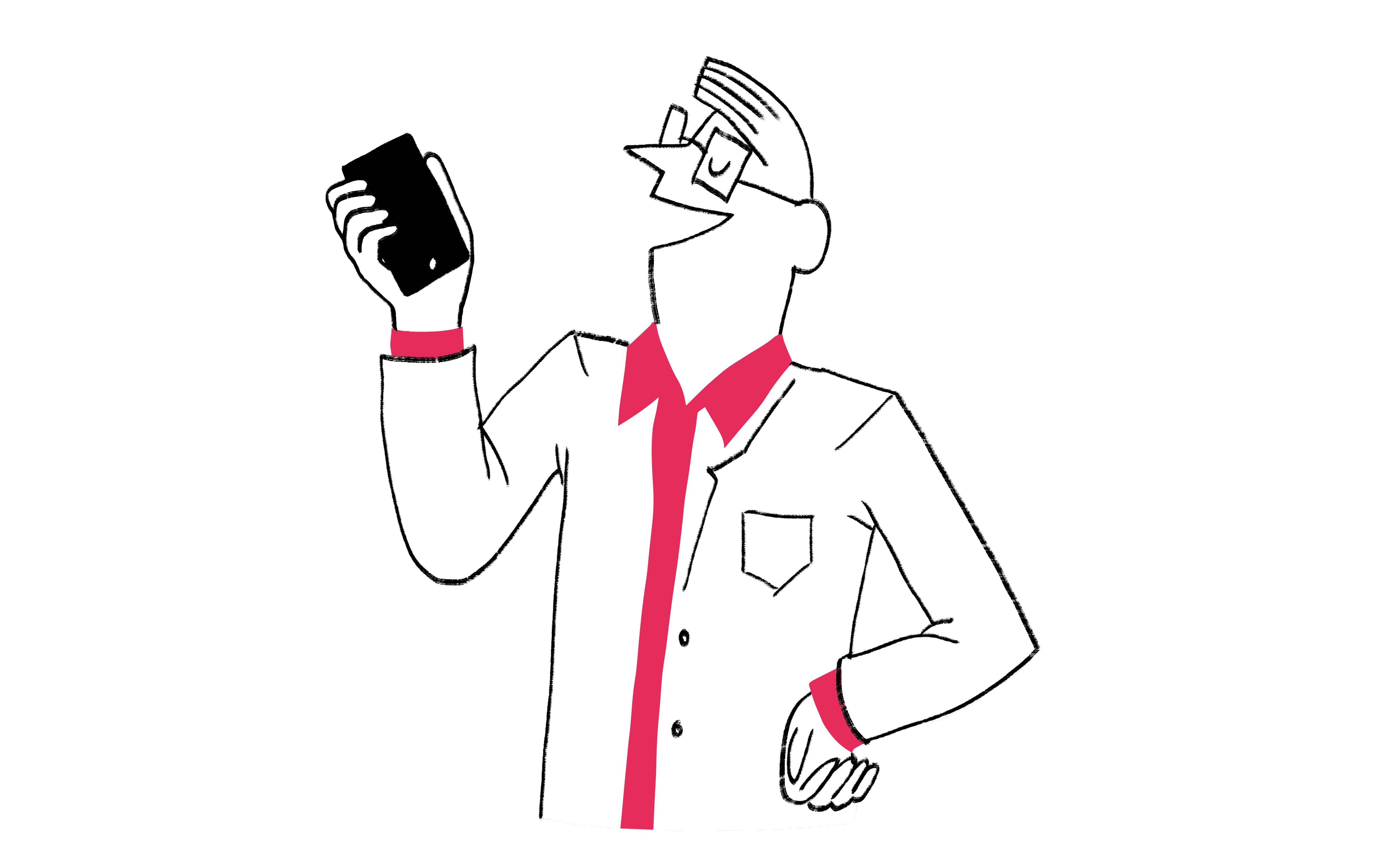La qualité de l'air intérieur des gares souterraines
La qualité de l’air est un véritable enjeu de santé publique. Dans cette optique, SNCF Gares & Connexions a entamé de nombreuses démarches pour connaître, comprendre et améliorer la qualité de l’air dans les gares souterraines d’Île-de-France.
Lancé depuis 2016, ce projet est mené en collaboration avec Airparif, organisme de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France. Le but de ce partenariat est d’une part de mesurer la qualité de l’air dans les gares souterraines franciliennes et déterminer l’ensemble des facteurs de pollution, et d’autre part d’être en mesure d’apporter des solutions spécifiques et concrètes.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Plan d’actions sur la Qualité de l’Air Intérieur en enceintes ferroviaires souterraines d’Ile-de-France Mobilités (IDFM).
 Copyright - Patrick Messina
Copyright - Patrick Messina
Les mesures
Dans les gares souterraines (fermées ou semi ouvertes), certains polluants extérieurs comme le dioxyde d’azote sont présents en plus faible quantité qu’à l’extérieur, ou quasiment absent comme l’ozone. D’autres, comme les particules, peuvent atteindre des niveaux plus élevés en heure de pointe, en raison du confinement. Elles sont principalement issues de l’exploitation ferroviaire et des travaux d’entretien ; une partie est également apportée par les voyageurs et par l’air extérieur.
Les niveaux mesurés varient selon la profondeur de la gare, son architecture, la présence, ou non d’un système de ventilation, le type de matériel roulant, la densité du trafic ferroviaire et la fréquentation en voyageurs.
Entre 2016 et 2021, toutes les gares souterraines franciliennes (soit 27 parmi les 392 gares que compte le réseau Transilien) ont fait l’objet d’une campagne de mesures, réalisée par Airparif ou l’Agence d’Essai Ferroviaire (AEF), laboratoire interne de la SNCF.
Les campagnes de mesure concernent la concentration en particules fines PM10 et PM 2.5 (particules de diamètre inférieur à 10 et 2,5 µm). La concentration d’éléments métalliques dans les PM 10 et les paramètres ambiants (température, humidité) sont également suivis.
En parallèle, 3 gares sont équipées de stations de mesures permanentes : Magenta (RER E), Avenue Foch (RER C) et Sevran-Beaudottes (RER B).
Les résultats :
Les rapports de toutes les campagnes sont disponibles en cliquant ici (Airparif) et https://eqair.sncf.fr/
Gares |
Ligne |
Partenaire |
Dates des campagnes de mesures |
|---|---|---|---|
Aéroport Charles de Gaulle 1 |
B |
Airparif |
juin 2017 |
Austerlitz souterrain |
C |
Airparif |
sept. 2016 |
Avenue du Président Kennedy |
C |
Airparif |
oct. 2017 |
Avenue Foch |
C |
Airparif |
En continu depuis avr. 2018 |
Bibliothèque François Mitterrand |
C |
Airparif |
oct 2018 |
Cergy Préfecture |
AL |
Airparif |
janv. 2017 |
Champ de Mars |
C |
Airparif |
juil. 2018 |
Evry Courcouronnes |
D |
Airparif |
déc. 2017 |
Grigny centre |
D |
Airparif |
juil. 2017 |
Haussmann St Lazare |
E |
Airparif |
oct. 2016 |
Le Bras de Fer |
D |
Airparif |
nov. 2016 |
Musée d'Orsay |
C |
Airparif |
avril 2018 |
Neuilly Porte Maillot |
C |
Airparif |
avr. 2017 |
Péreire Levallois |
C |
Airparif |
juin 2018 |
Pont de l'Alma |
C |
Airparif |
juin 2021 |
Porte de Clichy |
C |
Airparif |
sept. 2017 |
Saint Michel Notre Dame |
C |
Airparif |
En continu entre 12/2016 et 03/2018 |
Saint Ouen |
C |
Airparif |
mars 2017 |
Avenue Foch |
C |
AEF |
oct. 2016 |
Avenue Henri Martin |
C |
AEF |
mai 2017 |
Boulainvilliers |
C |
AEF |
sept. 2016 |
Cergy le Haut |
AL |
AEF |
juin 2017 |
Invalides |
C |
AEF |
nov. 2016 |
La Défense |
LU |
AEF |
déc.2017 |
Magenta |
E |
AEF |
En continu depuis janv. 2016 |
Paris Lyon RER |
D |
AEF |
déc.2016 |
Paris Nord RER |
BD |
AEF |
fév.2015 |
Sevran Beaudottes |
B |
AEF |
En continu depuis juin 2018 |
Un rapport de synthèse des 27 campagnes a été rédigé par Airparif et est disponible ici.

Baie de mesure Airparif en gare d’Avenue Foch
A noter qu’aujourd’hui il n’y a pas de valeur réglementaire pour les espaces ferroviaires souterrains.
Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ?
Les solutions à l'étude et en cours : le traitement de l’air
Entre 2019 et 2021, SNCF Gares & Connexions IDF a réalisé plusieurs expérimentations en gare pour tester des solutions identifiées via l’appel à projets de la Région Île-de-France « innovons pour l’air de nos stations ». Les résultats de ces expérimentations ont fait l’objet d’un rapport rédigé par AirLab ici :
Ces expérimentations ont montré des résultats encourageants mais nécessitent des tests complémentaires pour vérifier l’efficacité dans ces technologies dans le temps et à l’échelle d’une gare complète.
En 2023, une nouvelle phase s’engage pour étudier 2 technologies et en équiper 2 gares pour une expérimentation longue d’1 an : la solution de filtration proposée par Mann+Hummel est testée en gare de Porte de Clichy (RER C) ; la technologie de lavage à l’eau Terrao est testée en gare de Neuilly Porte Maillot (RER C).

Cubes de filtration de l’air – Mann+Hummel – gare de Porte de Clichy RER C

Système TerraoPur – Terrao - Neuilly Porte Maillot, RER C
Pour vérifier leur efficacité in situ, un protocole innovant d’instrumentation a été défini avec la mise en œuvre d’une vingtaine de capteurs dans chaque gare pour mesurer les particules.
Cette phase se déroulera entre mi 2025 et fin 2026.
Les solutions de ventilation
Assurer une ventilation des gares contribue à améliorer la qualité de l’air. Des solutions à long terme pour mettre en place des dispositifs de ventilation de confort sont en cours d’étude dans 2 gares.
Les nouvelles gares de la ligne EOLE (RER E) seront pourvues de moteurs mixtes de désenfumage/ventilation afin de renouveler régulièrement l’air des espaces quais.
Limiter les émissions par les rames
Une partie des particules fines provenant directement de l’activité ferroviaire, trois leviers d’amélioration sont en cours :
- évolution des semelles de freins pour qu’elles soient le moins émissives possibles,
- amélioration de l’efficacité de freinage sur les matériels actuels et les futurs (en favorisant le freinage électrique par rapport au freinage mécanique),
- passage à un mode de traction hybride des engins de travaux évoluant dans les tunnels.
Récupérer les particules à la source
Avec la société Tallano, Transilien et la Région Île de France testent l’aspiration à la source des particules provenant des systèmes de freinage, avant leur dispersion. Cette aspiration est réalisée par une turbine située à proximité du frein et est mise en fonctionnement au moment de chaque freinage.
Cette expérimentation - une première mondiale - se déroule sur 2 ans 1/2 (2018/mi- 2021), durée nécessaire pour évaluer la performance technique et économique du système.